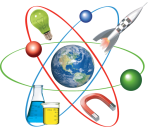La multiplication des échouages de cétacés apportent la preuve que des menaces pèsent sur la survie de ces créatures marines. Des géants gisant sur les côtes de la mer du Nord est un triste spectacle, mais c’est un événement qui offre aux scientifiques une précieuse opportunité de mesurer les dangers que représentent certaines activités humaines. Plusieurs corps on été retrouvés échoués sur une plage de l’est de l’angleterre. Peu de temps après, ce fut au tour de la Hollande et de l’Allemagne. Quels pouvait être le lien entre ces découvertes macabre? Une équipe de chercheurs se mit alors à la recherche de causes possibles, avant que les charognards et l’eau salée ne fassent disparaître les évidences potentielles. Cette équipe qui est composé de membres du Cetacean Strandings Investigation Programme (CSIP) dont le siège est au royaume-uni, a vu son travail mis en relief lors de nombreux échouages de cachalots sur les côtes britanniques, néerlandaises et allemandes ces derniers mois. Crée en 1990 en réponse à un virus qui tua des milliers de phoques en Europe, le CSIP fête cette année ses 25 ans. Le programme fut initié par le Musee d’Histoire Naturelle de Grande-bretagne, qui procédait déjà au recensement depuis 1913 . Avec plus d’un siècle de données collectées, c’est une mine d’informations pour les chercheurs. Durant le dernier quart de siècle le CSIP a recensé environ 12000 échouages, a réalisé 3500 autopsies, et collecté 80000 échantillons.
Le but principal du programme est d’établir les causes de ces échouages, mais c’est aussi l’occasion d’en apprendre un peu plus sur la vie marine. Les cachalots par exemple, passent une fraction de leur vie à la surface. Et c’est parfois lors d’autopsies que l’on découvre les effets désastreux de certaines substances chimiques. Utilisés dans la fabrication de canapés, des retardateurs de flammes à base de brome ont étés interdits en 2004 après la détection de traces dans des cadavres de marsouin. Concernant une hécatombe du début d’année 2012, de nombreuses hypothèses ont été avancées : courants marins, pollution aux métaux lourds (plomb, cadmium, cuivre), pesticides, infections bactériennes comme la leptospirose…Rappelons également que les cétacés sont très sensibles aux bruits sous-marins et souffrent de la multiplication des activités humaines. Même si les sonars et ondes sonores utilisés par les compagnies semblent sans conséquence sur l’environnement, ils seraient au contraire à l’origine de la désorientation des dauphins et de leur décès. la formation de micro bulles d’oxygène dans le sang des dauphins peut provoquer un syndrome de décompression, mettant à mal leur orientation et pouvant provoquer leur mort.
Le mystère des échouages de sujets sains reste toujours sans réponse. Des hypothèses sont évoquées: la rencontre de filets de pêche, le choc contre un navire… De futures investigations se porteront sur les menaces que représentent les tremblements de terre et les niveaux sonores sous-marins, d’autres sur la distribution des proies ou les migrations des cétacés. Les chiffres masquent de larges variations de population chaque année. S’il y a des échouages, c’est qu’il y a de nombreux individus. Si une espèce n’est pas recensée, c’est plus inquiétant. Certaines espèces sont directement menacées par la chasse à la baleine ou le rejet de produits chimiques. Malgré l’interdiction des PCB, leurs effets sont toujours mesurables sur la reproduction des cétacés. Plus récemment le CSIP a constaté une série d’échouages de tortues le long de la côte atlantique. Notamment la tortue de Kemp qui est en danger critique d’extinction. Classées comme étant gravement menacées, leur nombre a chuté de plusieurs centaines de milliers dans les années 40 à seulement quelques centaines de femelles capables de pondre dans les années 80. Le changement climatique pourrait aussi être en cause.
Un siècle de recherches sur les échouages de cétacés nous laisse l’espoir que les rapports entre humains et créatures marines peuvent encore changer. Il y a dix ans, des milliers de curieux se sont rassemblé pour observer une baleine à bec, égaré dans les eaux de la Tamise. Les sauveteurs l’avaient hissé à bord d’une barge dans l’espoir de pouvoir la ramener ensuite vers la mer, en vain. La baleine à bec, originaire de l’Atlantique Nord et qui, selon les experts, n’avait pas atteint son poids adulte, pesait environ trois tonnes et mesurait six mètres. L’animal était soit malade, soit avait perdu son sens de l’orientation en suivant des poissons pour se nourrir. La baleine à bec de l’Atlantique Nord, une espèce capable de descendre à 3.000 mètres de profondeur et qui se déplacent traditionnellement en groupe, s’est retrouvée bloquée par la marée basse. Ce fut la première fois que ce type d’espèce est signalé dans la Tamise. Si cet événement avait eu lieu 60 ans auparavant, la réponse des autorités aurait été toute autre. Les baleines étaient alors au coeur de l’industrie londonienne. Cela ne fait pas si longtemps, mais désormais cette nation est devenue l’un des acteurs majeurs de la protection des cétacés.