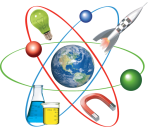Hubert Reeves a bien raison, nous sommes tous des poussières d’étoiles. C’est une expérience récente qui le confirme: le ribose, pièce cruciale de la machinerie cellulaire, peut se former dans un mélange de glaces soumises aux radiations ultraviolettes. Des glaces qui sont communes aux comètes. C’est un résultat très important dans le domaine de l’exobiologie. Les chercheurs travaillaient sur de la glace irradié depuis longtemps, mais n’avaient jamais eu la chance de détecter la formation de ribose. Le ribose est un peu la colonne vertébrale des processus biologiques, c’est un composant de l’ARN utilisé dans la transcription génétique et apparenté au désoxyribose qui est un composant de l’ADN. C’est également un composant de l’ATP (Adénosine triphosphate), et de diverses autres molécules importantes dans les processus métaboliques. Lors de cette expérience, de l’eau, de l’ammoniac et du méthanol qui sont des éléments que l’on retrouve sur les comètes, ont été soumis à une température de -195 degrés C° dans une chambre à vide. Afin de simuler les radiations d’une jeune étoile, l’échantillon était exposé à la lumière ultraviolette. Après mise à température ambiante, il s’est révélé riche en molécules organiques incluant le ribose. Ces résultats ne sont pas surprenants: cela fait 150 ans que la recherche dans le milieu de la chimie progresse, et l’astrochimie en tire profit. Un des challenges d’une telle expérience est d’éviter toute contamination. C’est grâce à la mesure des taux isotopiques dans l’échantillon que ces résultats semblent crédibles. Il est impossible de savoir si les molécules se sont formées à température basse ou ambiante. Les jeunes étoiles réchauffent périodiquement la ceinture de débris qui les entourent. Quant aux aux météorites, elles s’échauffent lorsqu’elles pénètrent notre atmosphère. Aucune étude ne démontre la présence de ribose à la surface ou dans un corps extraterrestre, mais les missions spatiales à venir seront autant de chance d’y parvenir.
D’autres pièces de la machinerie biologique avaient déjà été trouvées dans l’espace ou produites en laboratoire. L’année dernière des astro-chimistes ont réussi à créer dans un environnement spatial simulé trois des molécules présentes dans l’ADN et l’ARN: l’uracile, la cytosine et la thymine. On a aussi observé la présence d’acides aminés, les constituants des protéines, dans des météorites. En 2014, une molécule carbonée étonnamment complexe a été découverte dans un nuage de gaz interstellaire situé à 27 000 années-lumière de la Terre. Ce résultat suggère que les molécules complexes nécessaires à l’apparition de la vie peuvent se former dans l’espace interstellaire. En quoi est-ce si étonnant ? C’est que jusqu’à présent, les molécules carbonées qui avaient été détectées dans l’espace interstellaire étaient moins complexes : elles se caractérisaient généralement par un alignement des atomes de carbone les uns à la suite des autres, un peu comme les maillons d’une chaîne, et non par une structure ramifiée comme c’est le cas de l’isopropyl cyanide. Le radiotélescope d’Arecibo, bien qu’en service depuis plus de 40 ans, continue d’être à la source de découvertes, comme celle de la présence à 250 millions d’années-lumière de deux molécules permettant la synthèse d’un acide aminé. Le cyanure d’hydrogène est un liquide ou un gaz incolore à des températures normales sur Terre, et qui a probablement joué un rôle central dans la synthèse prébiotique des acides aminés et des purines. Le fait qu’on le trouve en abondance dans les comètes à nourrir les spéculations sur l’importance des collisions cométaires dans l’apparition de la vie sur Terre. C’est une molécule simple, mais en présence d’eau, elle conduit facilement à la synthèse de la glycine, l’un des acides aminés essentiels des organismes vivants. La méthanimine est aussi une molécule organique qui conduit à la glycine en solution dans de l’eau. Or, un groupe d’astronomes utilisant le radiotélescope d’Arecibo à Porto Rico a découvert la présence de ces deux molécules importantes pour l’apparition de la vie dans une galaxie à 250 millions d’années-lumière. Cette galaxie est connue pour être le lieu d’une formation stellaire considérable et le fait que ces molécules soient détectables à une telle distance indique qu’elles doivent y être présentes en quantités énormes.
Dans deux météorites célèbres, celle d’Orgueil et celle de Murchison, une équipe de la NASA a découvert parmi les acides aminés présents un excès de la forme dite gauche. Ce déséquilibre rappelle une caractéristique énigmatique de ces molécules qui forment les protéines de la vie terrestre, uniquement composées de formes gauches.A l’instar des 26 lettres de l’alphabet, qui peuvent être réorganisées pour donner des combinaisons à l’infini, la vie utilise 20 acides aminés différents, combinés pour donner des protéines différentes par millions. Les molécules des acides aminés sont formées de deux manières : il y a d’un côté les acides aminés « gauchers » et de l’autre les « droitiers ». La vie sur Terre existe grâce aux premiers, uniquement. Depuis longtemps l’idée a été émise que l’explication pourrait se trouver dans l’espace. En 1969, une météorite est tombée sur le village américain de Murchison. Il s’agissait d’une chondrite carbonée et son analyse a révélé qu’elle contenait quelque 70 acides aminés dont 8 font partie des 20 qui composent les protéines de tous les êtres vivants terrestres. L’analyse a aussi décelé des purines et des pyrimidines, c’est-à-dire des molécules semblables à celles présentes dans l’ARN et l’ADN. Pour les auteurs, ces résultats ne peuvent s’expliquer que par une longue exposition à des ultraviolets polarisés qui auraient forgé davantage une forme que l’autre. Le déséquilibre a dû se produire durant une longue phase d’altération dans le corps massif dont la destruction a produit ces petits astéroïdes qui ont un jour rencontré la Terre. Il est tout à fait possible que notre planète, au début de sa formation et de celle du système solaire, ait reçu de tels acides aminés majoritairement lévogyres. Les mécanismes chimiques à l’origine de la vie auraient alors pu conduire à ne conserver que cette forme. Nous conserverions ainsi en nous, comme tous les êtres vivants de la Terre, la trace d’un phénomène physique qui a eu lieu quelque part autour du Soleil il y a plusieurs milliards d’années.