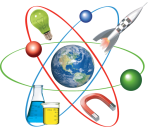Les capybaras, des rongeurs géants natifs de l’Amérique du sud, pourraient devenir la prochaine espèce invasive de la Floride: c’est l’avertissement d’une biologiste à la 53e conférence annuelle de l’Animal Behavior Society. Les capybaras ont été introduit au nord de la Floride et possèdent de nombreuses similarités avec les ragondins (Myocastor coypus). Ils seraient actuellement une cinquantaine d’individus, et cela ne ressemble en rien à une invasion. Mais ces animaux sont les plus grands rongeurs du monde, pouvant atteindre plus de 50 kilogrammes. En milieu sauvage, ce mammifère semi-aquatique vit en groupes sociaux dans les forêts proches d’étendues d’eau comme les rivières, les lacs ou les marais. Ce sont des herbivores qui peuvent subsister d’une large variété de végétations et se reproduisent à bon rythme.
Beaucoup de gens ne réfléchissent pas à leurs caractéristiques, et les capybaras se sont retrouvés parmi les créatures exotiques que l’homme a essayé de transformer en animal de compagnie. Cela a conduit à un phénomène que l’on connaît bien: l’abandon pur et simple de façon anarchique et sauvage dans la nature lorsqu’il devient trop encombrant. La différence entre espèce exotique invasive et non invasive ne tiens qu’aux dégâts causés sur l’environnement, sur la santé ou l’économie. Une équipe de chercheurs a étudié le danger potentiel que représentent les capybaras en comparant leurs similarités avec les ragondins. Ces grands rongeurs furent importés aux États-Unis au début du 19e siècle pour être élevé pour leur fourrure en Louisiane. Certains se sont échappé ou été relâché et se sont reproduit. Les tentatives de contrôler leur population ont toutes échoué.
Les ragondins qui sont plus petits que les capybaras se reproduisent à peu près au même rythme. Ce qui fait des ragondins une menace qu’ils ne partagent pas avec les capybaras, c’est leur tendance à creuser le lit des rivières, des digues et d’autres places qui peuvent poser des problèmes de dégradation des sols. Tandis que les coyotes et les chiens sont réputés pour chasser les ragondins, il semble qu’aucune espèce aux États-Unis ( hormis l’homme) ne soit capable de tuer un capybara. Ses prédateurs naturels sont les anacondas, les pumas ou les jaguars. Il n’existe aucune preuve concrète selon les autorités de Floride, mais de nombreux signes écologiques auraient déjà été appercus et donnerons peut-être la malchance de suivre et d’observer un processus d’invasion. Affaire à suivre….
En français il est nommé Capybara, aussi orthographié parfois Capibara. Le nom de « capybara » vient de « capivara », mot qui signifie « Seigneur des herbes » dans la langue des indiens Guaranis. On l’appelle aussi cabiai ou Cabiaï, notamment en Guyane et au Canada, Carpincho, Cochon d’eau ou Hydrochère, ou encore Grand cabiaï, Grand cochon d’eau ou Grand hydrochère pour le distinguer du Cabiaï de Panama. Il se nomme capivara au Brésil (origine du nom), carpincho en Argentine et en Uruguay et chigüire ou chigüiro au Venezuela, rosonco au Pérou et lapa ou chigüiro en Colombie, Capiguara en Bolivie…
Le corps du capybara est couvert de poils durs bruns et sa tête a un large museau. Ses yeux sont petits et situés au-dessus du nez qui est surmonté à son tour par une glande qui sert à marquer les objets avec ses sécrétions. Ses oreilles sont petites et arrondies. Il n’a pas de queue. Ses pattes de devant ont 4 doigts, celles de derrière ont 3 doigts. Il laisse des traces très caractéristiques sur les sols humides. Il est diurne et sa longévité est d’une douzaine d’années. La femelle cabiai peut avoir de deux à huit petits par portée avec une moyenne de quatre. La gestation dure approximativement 130 jours. Les nouveau-nés peuvent accompagner leur mère et manger comme elle, mais ils boivent du lait et ne sont pas sevrés avant 16 semaines. Les capybaras sont d’excellents nageurs. Le capybara fonde sa survie sur une étonnante cohésion sociale : il n’est pas rare que, dans un groupe formé d’une vingtaine d’animaux (3 à 4 mâles, 6 à 8 femelles et les jeunes), les jeunes d’âges divers soient confiés à l’un des adultes, mâle ou femelle. Ce « jardin d’enfants » permet aux parents de se baigner, de se nourrir ou de s’enduire de boue sans trop de risques pour leur progéniture. Il est aussi admis qu’une femelle allaitante se laisse téter par tous les petits du même groupe. Le mâle qui marque son territoire dirige le groupe.